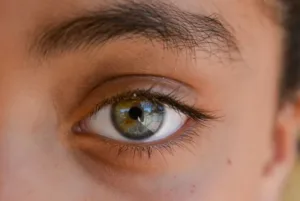
Double exceptionnalité : mieux comprendre pour mieux aider
La double exceptionnalité (HPI + trouble associé) est souvent mal comprise. Découvrez pourquoi il est essentiel de valoriser le Haut
Besoin d’un avis extérieur ?
30 minutes pour
clarifier votre situation.
Quand on devient parent, la plupart du temps, on s’imagine changer de statut et rentrer dans le rôle qu’on a vu chez ses propres parents, chez les parents de nos amis ou chez nos amis avec enfants. L’enjeu premier est : je veux être un bon parent, avec toutes les représentations que cela signifie.
Puis, un jour, pour certains, on découvre que notre enfant n’est pas un enfant “comme les autres”. Parce qu’il a un QI élevé, un trouble cognitif, une pathologie. Ou parce qu’on découvre son propre profil et qu’il est héréditaire, comme le HPI. Ce jour-là, on n’est plus un parent “comme les autres” — et on s’aperçoit qu’on ne sait pas forcément quel parent devenir.
C’est le moment où il s’agit de construire une parentalité atypique.
Cet article s’inscrit dans une réflexion plus large sur la parentalité atypique, lorsque les repères éducatifs classiques cessent d’être efficaces face au fonctionnement HPI.
Dans les grandes lignes, les schémas d’éducation classique ne répondent pas aux besoins des enfants HPI. Pas parce qu’ils sont « plus intelligents », « mal élevés », « ingérables » ou « provocateurs ». Mais parce qu’ils fonctionnent autrement. Parce qu’ils ressentent intensément, pensent vite, questionnent tout. Parce qu’ils sont HPI, et que cette différence invisible vient heurter de plein fouet nos automatismes éducatifs.
Chez beaucoup de parents, cette prise de conscience prend plusieurs années de lutte silencieuse, de déni inconscient. Les routines ne tiennent pas. Les crises surgissent à contre-temps. L’école alerte, la fratrie remue, les parents s’épuisent. Et ce qui fonctionne “chez les autres” semble inefficace.
Parler de votre situation
Sans engagement. Juste pour vous aider à faire le tri.
Quand je reçois des parents, c’est souvent par cette phrase que commence l’accompagnement. Tentatives d’autorité, négociation, bienveillance à toute épreuve, sanctions, contrats, récompenses, culpabilité, lectures, forums, rendez-vous médicaux… tout y passe. Mais rien ne tient.
Et pour cause. Le cadre classique ne peut pas contenir un enfant qui ne fonctionne pas classiquement.
Le HPI, ce n’est pas “juste un peu plus intelligent”. C’est une autre manière de traiter l’information, de ressentir, de se positionner dans le monde. Et quand on applique une parentalité standard à un enfant atypique, on provoque, sans le vouloir, des effets secondaires : perte d’estime, sentiment d’injustice, repli, colère rentrée, suradaptation.
Face à ce décalage, si le noyau parental éducatif n’a pas opéré une transformation, deux options s’installent souvent : l’enfant entre en opposition frontale, ou bien il développe un faux-self. Il devient l’enfant que les adultes attendent, au prix de sa vitalité. Il se coupe de lui-même pour préserver le lien. Ce mécanisme de survie est redoutablement efficace… jusqu’à ce qu’il ne le soit plus. C’est le chemin vers un burn-out scolaire ou émotionnel.
Les parents, eux aussi, s’adaptent. Par épuisement, par amour, par désespoir parfois. Mais lorsque l’on s’adapte à répétition sans poser de sens, on finit par douter de soi, perdre pied, se déconnecter.
Alors, on tente une autre voie.

À lire aussi :
Construire une parentalité atypique, ce n’est pas “faire encore plus d’efforts” ni “laisser faire”. C’est déconstruire une partie de ce que l’on croit être un “bon parent”, pour reconstruire une posture juste face à un enfant qui appelle autre chose.
Cela demande du courage. De la nuance. Et une capacité à se remettre en question sans se flageller. Car il ne s’agit pas d’avoir tout bon, mais de réapprendre à écouter, à observer, à comprendre ce qui se joue au-delà des comportements.
Ce premier article ouvre un cycle. Non pas pour vous donner des recettes, mais pour penser ensemble cette parentalité hors-norme, ses vertiges et ses forces, ses points de rupture et ses points d’appui.
Parce que si le modèle ne fonctionne pas, ce n’est pas que vous faites mal. C’est qu’il faut certainement oser en créer un nouveau.
Repartir avec une direction claire, en 30 minutes.
Partagez cet article
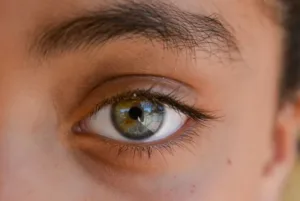
La double exceptionnalité (HPI + trouble associé) est souvent mal comprise. Découvrez pourquoi il est essentiel de valoriser le Haut

Le terme “harcèlement scolaire” permet de caractériser un conflit récurrent entre enfants. Bien le comprendre permet une meilleure prise en

Avez-vous cliqué sur ce titre pour en savoir plus sur votre éventuelle psychopathie ou votre sérieux problème de socialisation ?