
Le confinement et les enfants surdoués
Désœuvrement, emploi du temps, travail scolaire ou relations sociales. Le confinement oblige l’enfant HPI à réinventer son organisation personnelle. Et,
Besoin d’un avis extérieur ?
30 minutes pour
clarifier votre situation.
Quand un adolescent HPI commence à aller mal, la machine à interpréter s’enclenche rapidement. Et dans cette course au sens, le risque est grand de poser un diagnostic avant d’avoir vraiment écouté.
Un mal-être prolongé, une baisse de motivation, une rupture dans les liens sociaux, un retrait ou une réactivité émotionnelle inhabituelle… tous ces signes peuvent conduire à une consultation. C’est une bonne chose, en apparence. Mais encore faut-il que cette consultation tienne compte du fonctionnement cognitif spécifique de l’adolescent. Car un HPI qui va mal ne va pas comme les autres. Et un HPI qui s’adapte peut passer pour quelqu’un qui va bien.
Comprendre la santé mentale des adolescents HPI suppose de replacer les symptômes dans leur contexte global. Sans cette lecture, le risque est de confondre souffrance adaptative, surcharge et trouble avéré.
La souffrance des adolescents à haut potentiel est souvent mal lue. Elle peut prendre les traits d’une anxiété généralisée, d’un début de phobie scolaire, d’un trouble du spectre autistique, voire d’un épisode dépressif atypique. Dans certains cas, plusieurs diagnostics s’empilent, chacun essayant d’expliquer une facette de ce qui est en fait un décalage structurel entre l’environnement et le fonctionnement.
Chez ces jeunes, l’intensité, la pensée en boucle, la saturation émotionnelle ou la distance sociale ne relèvent pas forcément d’un trouble. Ce sont souvent des mécanismes de régulation, des formes d’auto-protection face à un monde vécu comme flou, exigeant, ou contradictoire.
Parler de votre situation
Sans engagement. Juste pour vous aider à faire le tri.
Ce qui complique encore le repérage, c’est que le profil HPI est souvent perçu comme protecteur. On croit, à tort, qu’un adolescent intelligent saura s’en sortir, qu’il saura dire ce qui ne va pas, ou qu’il exagère ses difficultés. Mais chez ces jeunes, la capacité à verbaliser ne signifie pas qu’ils se sentent compris. Et le calme apparent ne signifie pas qu’ils vont bien.
Certains adolescents développent une forme de suradaptation silencieuse. Ils adoptent un langage abstrait, théorique, très contrôlé. Ils parlent de ce qu’ils pensent, mais pas de ce qu’ils ressentent. Ils donnent l’impression de recul, mais c’est parfois une forme de dissociation douce. Un sourire poli, un regard maîtrisé, une présence attentive… tout semble à sa place. Et pourtant, rien ne circule.
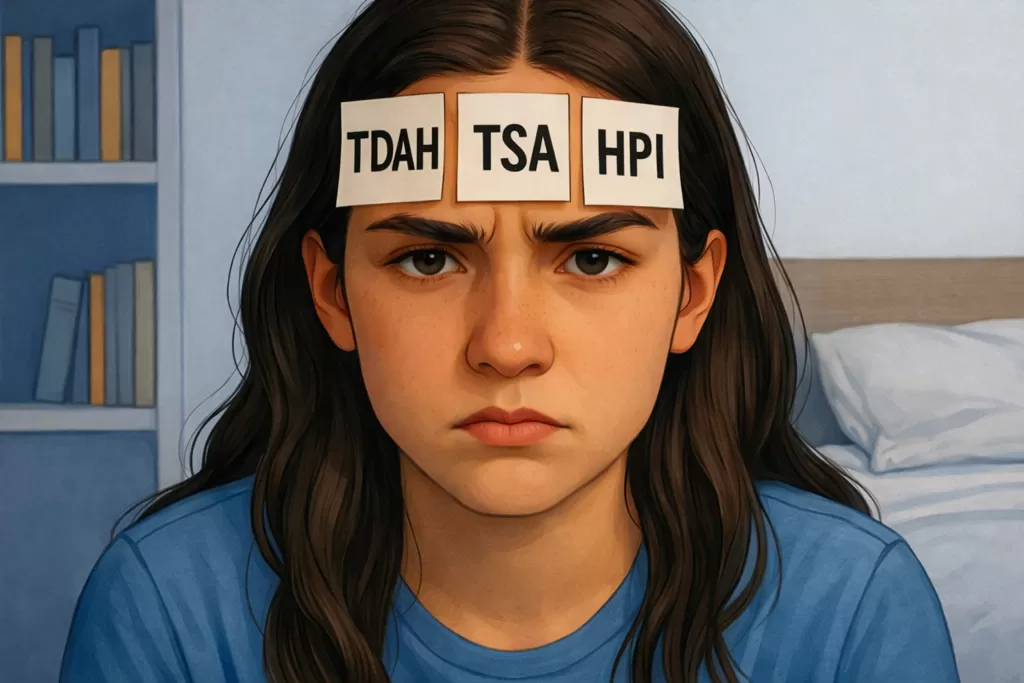
Dans les accompagnements que je mène, plusieurs indicateurs reviennent, discrets mais récurrents :
D’autres adolescents se replient dans un domaine unique : manga, musique, jeux vidéo, sport intensif… Non pas par passion uniquement, mais pour éviter tout le reste. Le monde réel devient trop exigeant, trop illisible. Alors ils se réfugient dans un ailleurs qu’ils maîtrisent.
Parfois, ces jeunes finissent par dire : « Je sais que je devrais aller mieux, mais je ne sais pas comment. » Ou bien ils ne disent finalement plus rien du tout et ferment les écoutilles.
Le problème n’est pas d’accueillir un adolescent HPI en souffrance. Le problème, c’est de systématiquement chercher une étiquette avant de comprendre la structure. Un diagnostic peut parfois soulager et mettre un mot sur une douleur floue. Mais trop souvent, il enferme et explique sans relier. Il rassure les adultes sans alléger l’adolescent.
C’est pourquoi la psychoéducation est une clé majeure. Il ne s’agit pas de “défendre le HPI” contre les diagnostics, mais de rappeler que tout diagnostic doit être recontextualisé à un fonctionnement cognitif atypique.
Cela passe par :
Ce que l’adolescent attend, sans le dire
Ce que ces jeunes attendent, ce n’est pas d’être définis. C’est d’être rejoints. Ils ne cherchent pas une réponse immédiate, mais un cadre stable où ils peuvent explorer leur propre fonctionnement sans se sentir jugés, classés ou réduits.
Ils ont besoin qu’on cesse de les évaluer, même avec bienveillance.
Ils ont besoin qu’on écoute ce qui est dit… et ce qui ne l’est pas.
Ils ont besoin de temps. Pas de pression thérapeutique. Pas de « solution ».
Accompagner un ado HPI en souffrance, ce n’est pas cocher une case dans la liste des maladies. C’est ouvrir un espace où il peut être autrement.
Et parfois, c’est l’absence de diagnostic qui fait le plus de bien.
Repartir avec une direction claire, en 30 minutes.
Partagez cet article

Désœuvrement, emploi du temps, travail scolaire ou relations sociales. Le confinement oblige l’enfant HPI à réinventer son organisation personnelle. Et,

Les HPI maîtrisent 7 des 10 soft skies attendues par les entreprises. Pourtant, ils peinent à faire reconnaître leur plus-value.
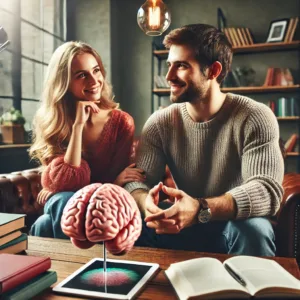
Une étude récente confirme l’égalité intellectuelle entre hommes et femmes, défiant les stéréotypes de genre et favorisant l’individualité.